Membre de ClickFR, Reseau francophone Paie-Par-Click |
© TERRAVITA, Frédéric BLASSELLE.
Sommaire :
-
I ) Introduction.
-
II ) Que sont les plaques tectoniques ?
- la tectonique des plaques
- différentes
frontières tectoniques
- l’origine des plaques
-
III ) L’influence du mouvement des plaques tectoniques sur
la division des continents.
- les
mouvemnts divergents
- les
mouvements convergents
- les frontières transformantes
-
IV ) Les déplacements des continents de la Pangée à nos
jours.
-
l’hypothèse de Wegener
-
les déplacements des continents
I ) Introduction.
Nos continents
reposent sur d’immenses plaques, appelées plaques tectoniques. Notre objectif
sera d’expliquer l’influence qu’ont ces plaques sur ce phénomène
surprenant qu’est la division des continents. Mais comment expliquer que ces
plaques sont à l’origine de ces mouvements ? Pour répondre à cette
question nous allons tout d’abord définir plus clairement ce que sont les
plaques tectoniques, ensuite nous étudirons l’influence qu’elles ont sur la
division des continents, puis nous parlerons de l’évolution des mouvements de
la masse continentale avant d’apporter une conclusion quant au problème posé.
II ) Que sont les plaques
tectoniques ?
a)
la
tectonique des plaques.
La
tectonique est une partie de la géologie qui étudie la nature et les causes
des déformations des ensembles rocheux. Dans notre cas, nous nous
interresseront plus particulièrement aux déformation à l’échelle
terrestre. D’après la théorie formulée par plusieurs géophysiciens, la
croute terrestre serait composée de 6 grandes plaques tectoniques rigides qui
se déplacent sur l’asthénoshère ( une couche visqueuse située à 100 km de
profondeur ). Leur vitesse de déplacement est variable :
|
Plaque
pacifique |
10cm
/ an vers le Nord-Ouest |
|
Plaque
eurasiatique |
1cm
/ an vers l’Est |
|
Plaque
américaine |
1cm
/ an vers l’Ouest |
|
Plaque
africaine |
2cm
/ an vers le Nord |
|
Plaque
antarctique |
Tourne
sur elle-même |
|
Plaque
indo-australienne |
7cm
/ an vers le Nord |
b) différentes frontières tectoniques.
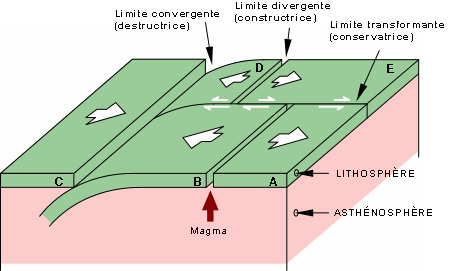
Ces
mouvements définissent trois types de frontières entre les plaques:
1) les
frontières divergentes, là où les plaques s'éloignent l'une de l'autre et où
il y a production de nouvelle croûte océanique; ici, entre les plaques A et B,
et D et E;
2)
les frontières convergentes, là où deux plaques entrent en collision, conséquence
de la divergence; ici, entre les plaques B et C, et D et C;
3) les
frontières transformantes, lorsque deux plaques glissent latéralement l'une
contre l'autre, le long de failles; ce type de limites permet d'accomoder des
différences de vitesses dans le déplacement de plaques les unes par rapport
aux autres, comme ici entre A et E, et entre B et D, ou même des inversions du
sens du déplacement, comme ici entre les plaques B et E.
c ) l’origine des plaques.
L'intérieur de la Terre est composé de roches faiblement radioactives dont la désintégration produit de la chaleur. Certaines zones du manteau deviennent donc chaudes, et se mettent à monter vers la surface sous l'effet de la force d'Archimède (plus chaud = moins dense, d’où montée). Une fois refroidie en surface (ce qui évacue la chaleur produite par l'intérieur de la Terre), la matière replonge vers les profondeurs (plus froid = plus dense, d’où descente). Le système s'organise de telle façon que des zones "stables" apparaissent : à certains endroit la matière monte (ce sont les dorsales), à d'autres endroits elle redescend (ce sont les zones de subduction). En surface, la matière est simplement translaté des dorsales vers les subductions. Sous l'effet du refroidissement, cette matière devient cassante, c'est à dire qu'elle constitue des grandes plaques d'une certaine épaisseur (entre 10 et 100 km). C'est ce mouvement, appelé tectonique des plaques qui donne lieu à la dérive des continents.
III ) Les différents types de mouvement des plaques au niveau des continents.
a)
les
mouvements divergents
Il y a un flux de
chaleur qui va du centre vers l'extérieur de la terre,
causé par la
désintégration
radioactive de certains éléments chimiques. Les matériaux
chauffés au centre
de la terre sont moins denses que ceux en surface et ont donc
tendance à remonter
à la surface. Une fois refroidis, ils redeviennent plus denses
et redescendent donc
vers le centre de la terre avant de remonter à nouveau,
etc…Le flux de
chaleur à pour effet de soulever la croûte océanique, ce qui
correspond à la
dorsale océanique. La chaleur fait aussi fondre le manteau en
produisant du magma.
Ces mouvements de matière sont à l’origine de la
séparation des deux
plaques de chaque côté de la dorsale océanique. Le magma
remplace la croûte
océanique qui manque sur la dorsale.
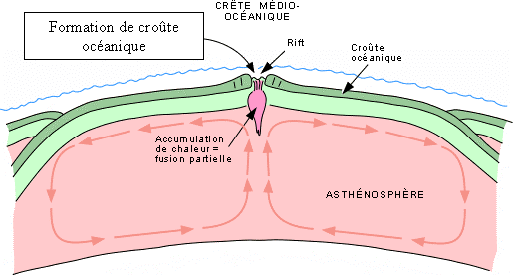
Ce type
de mouvement est aussi à l’origine de la création d’océans, comme nous
allons
tenter de l’expliquer. Il y a un soulèvement de la lithosphère continentale
à cause
du flux de chaleur, comme nous l’avons déjà dit. Les mouvements de
divergence
fracturent la lithosphère. Le magma s'infiltre dans les fissures, ce qui
cause
par endroits du volcanisme continental; les laves forment des volcans ou
bien s'écoulent
le long des fissures.
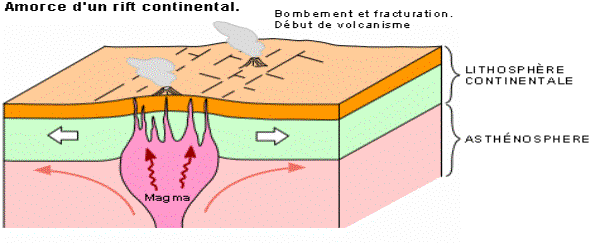
Les
mouvements de divergence étirent encore plus la lithosphère, qui s’effondre
en
escalier : c’est le rift continental.
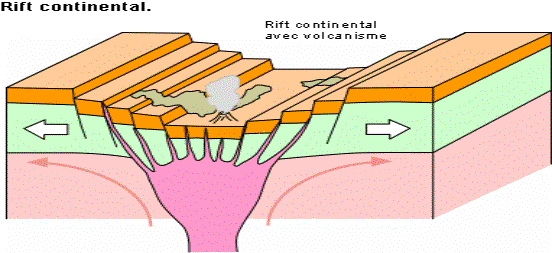
Bientôt,
les eaux de mer dépassent le niveau du rift et l’innondent. La
lithosphère
se casse en deux parties qui s’éloignent. C’est ce qu’on appelle une
mer linéaire.
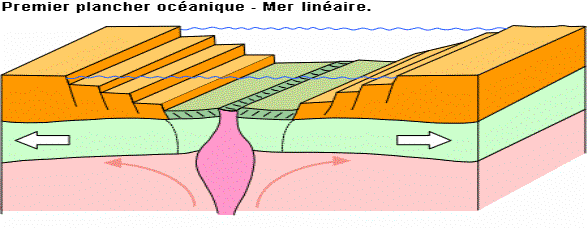
Avec le
temps, la lithosphère continue à s’écarter et la mer transforme les côtes.
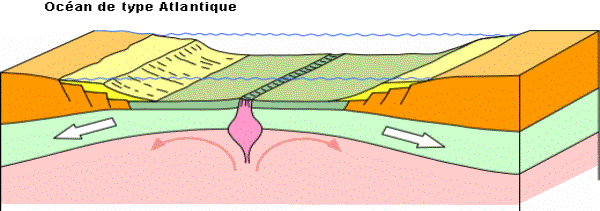
b) les mouvements divergents.
Aujourd'hui, les
physiciens, pensant que la matière terrestre reste contsante, sont
d'accord pour dire
que, si les plaques sont en expansion aux frontières
divergentes, il
faudra détruire de la lithosphère ailleurs. Cette destruction se fait
aux frontières
convergentes qui, comme le nom l'indique, marquent le contact
entre deux plaques
lithosphériques qui convergent l'une vers l'autre. La
destruction de
plaque se fait par l'enfoncement dans l'asthénosphère d'une plaque
sous l'autre plaque.
La plaque la plus dense s’enfonce sous la moins dense. Il
peut y avoir différents
résultats : nous allons étudier la formation d’une chaîne
de montagne.
L’asthénosphère est très dense, plus que la lithosphère. La colision
est donc terrible et
tous les sédiments se soulèvent. Une chaîne de montagne est
formée de cette
manière.
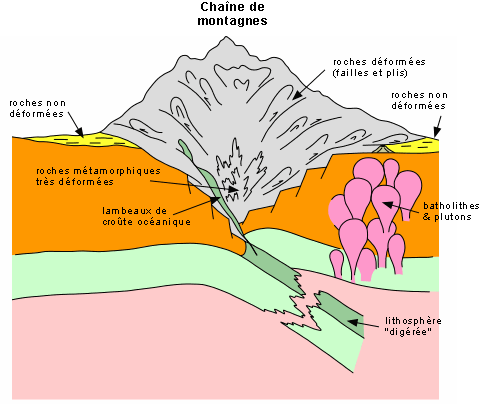
Toutes
les grandes chaînes de montagnes ont été formées par ce mécanisme. Un
bon
exemple récent de cette situation, c'est la soudure de l'Inde au continent
asiatique,
il y a à peine quelques millions d'années, avec la formation des
c) les frontières transformantes.
Les frontières
transformantes, qu’on appelle généralement failles, sont de
grandes fractures
qui affectent toute l'épaisseur de la lithosphère. On les trouve
souvent dans la
lithosphère océanique. Deux plaques ayant des vitesses
différentes ou
encore des sens contraires « glissent » le long de ces failles.
Voici
un bon exemple de
faille : la faille de San Andréas. La plaque Nord-Américaine
ont des sens différents
et glissent le long de cette frontière. Dans quelques
millions d’années,
la ville de Los Angeles se trouvera sur la même ligne que San
Francisco.
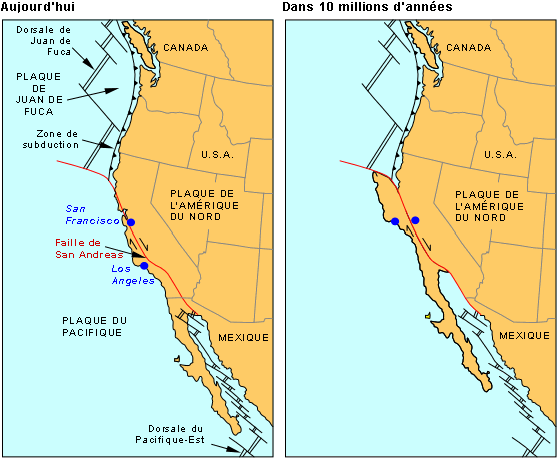
A- L’hypothèse de Wegener à nos jours
Au début du vingtième siècle, la structure de la Terre est mal connue,
son histoire est balbutiante. Il y a des modèles mais ils ne s’appliquent pas
à l’ensemble de la tectonique et ils ne sont pas dynamiques. Les continents
et les océans, dont on ignore la structure fine, sont fixes. Ils peuvent
parfois s’effondrer.
S’appuyant
sur des arguments divers, Wegener (1880-1930) émet l’hypothèse
qu’autrefois les continents étaient réunis. La place qu’ils occupent
actuellement résulte d’un déplacement latéral à la manière d’un radeau.
Ces arguments sont :
-
géographiques : les formes des côtes des continents sont grossièrement
complémentaires.
-
géologiques :
des structures géologiques de même type, datées de plus de 250 millions
d’année, sont localisées sur des continents aux côtes complémentaires.
-
climatiques :
on observe des traces de glaciation de plus de 250 millions d’années sur des
continents qui sont actuellement sur des zones tropicales.
-
biologiques :
on trouve actuellement de part et d’autre de l’Atlantique des fossiles
d’êtres vivants datées de 240 à 260 millions d’années. Ils
n’ont pas pu traverser l’Atlantique.
-
le moteur :
de tels déplacements sur de longues périodes nécessitent un moteur. Pour
Wegener, les mécanismes à l’origine des déplacements latéraux sont
<<la force
répulsive des pôles>> et <<le frottement des marrées>>.
La démonstration de la présence d’un supercontinent (la Pangée) a
convaincu les scientifiques. Cependant, il rejette l’hypothèse des moteurs :
ils sont jugés insuffisants.
A partir des années 1950, la découverte progressive de la topographie
et de la structure des fonds océaniques a totalement révolutionné les
connaissances dans le domaine des sciences de la Terre.
L’utilisation
de sonars de plus en plus perfectionnés à permis de dresser avec la plus
grande précision la carte topographique des fonds océaniques. La découverte
la plus surprenante a sans doute été la mise en évidence d’une chaîne de
montagne sous-marine, la dorsale, qui surplombe de 2000 à3000 mètres les
plaines abyssales et serpente sur plus de 60000 kilomètres dans tous les océans
du monde.
B-
Les déplacements des continents
IL, y a 250 millions d’années, il n’existait qu’un supercontinent,
la Pangée. En se fissurant, il a
donné naissance à plusieurs blocs, les continents actuels, qui, peu à peu, se
sont détachés et se sont éloignés les uns des autres. C’est ce qu’on
appelle la<<dérive des continents>>.
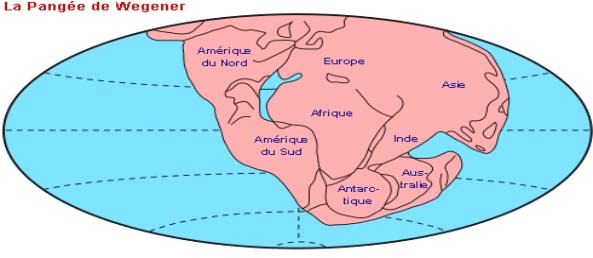
La Terre, il y a 65 millions d ‘années : l’Amérique du
Sud est séparée de l’Afrique et dérive vers le Nord-Ouest tandis que l’océan
Atlantique s’élargit.
Aujourd’hui, l’Inde est attachée à l’Asie, l’Amérique du Nord
est attachée à l’Amérique du Sud tandis que l’Australie s’est séparée
de l’Antarctique. Les continents poursuivent toujours leur dérive
puisqu’ils se déplacent en moyenne de 2cm par an : l’Amérique du Nord
s’éloigne de l’Europe et l’Australie se rapproche de l’Asie.
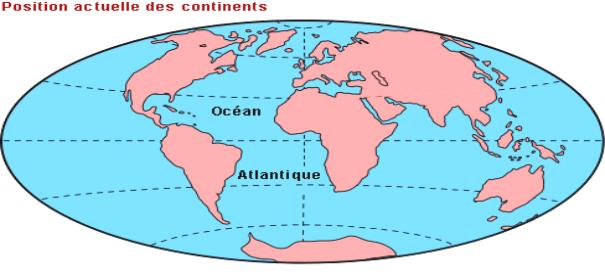
Sources :
-
encyclopédie Larousse
-
dictionnaire « le petit Larousse »
-
livre Hachette SVT 1ère
-
divers sites internet
© TERRAVITA, Frédéric BLASSELLE.